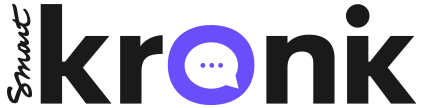Des associations « biberonnées aux subsides », des entreprises « créatrices d’emplois » mais « étranglées par les taxes » : le cliché a la vie dure. Pourtant, la réalité budgétaire le dément point par point.
La saison des conclaves budgétaires est ouverte et l’heure est à l’austérité budgétaire. Qu’il s’agisse du niveau fédéral, de celui des régions ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les responsables désignés des « dérapages » budgétaires sont systématiquement les mêmes : la fonction publique, l’enseignement, le monde associatif, la santé, l’économie sociale, etc. En règle générale, les secteurs dits « non marchands » de l’économie belge sont, une nouvelle fois, appelés à se serrer la ceinture sans tenir compte, jamais, du rôle qu’ils jouent dans la société.
Pourtant, dans une récente étude, le réseau Éconosphères estime le soutien public (par le biais de subventions, de réductions d’impôts ou de cotisations de Sécurité sociale) aux entreprises privées lucratives à près de 52 milliards d’euros (1) en 2022. Au regard des 300 millions d’euros d’économie à réaliser en Fédération Wallonie-Bruxelles ou même des 26 milliards à l’échelon fédéral, ce chiffre important laisse perplexe. Depuis 20 ans, ce soutien n’a cessé d’augmenter (2). Sur les deux dernières décennies, il a augmenté, en moyenne, de 4,6 % par an hors inflation. Or, pendant cette même période, le PIB a crû de 1,5 % par an et les prestations sociales de 2,2 %.
Peu d’évaluation
En comparaison, les divers dispositifs publics de soutien aux entreprises ont augmenté 1,5 fois plus rapidement que les dépenses sociales et 1,8 fois plus rapidement que le PIB. Ces chiffres font écho à la situation française où une commission d’enquête parlementaire a récemment dénombré plus de 2.200 dispositifs publics d’aide aux entreprises pour un montant total estimé à 211 milliards d’euros en 2023 (3), ce qui fait du soutien public aux entreprises la première politique publique dans l’Hexagone.
Pour quel résultat en Belgique ? Les baisses successives de cotisations patronales, par exemple, ne semblent pas avoir d’effet structurel sur l’emploi (4) dans le secteur privé en Belgique et le soutien public ne semble pas plus avoir un impact visible sur l’investissement productif dans nos régions. Ces résultats très mitigés posent une question : faut-il continuer à financer la compétitivité des entreprises en Belgique par un transfert d’argent des budgets de l’État et de la Sécurité sociale vers les secteurs privés lucratifs ? D’autant que certains dispositifs d’aide sont très peu conditionnés et évalués et qu’il n’existe, à l’échelle du pays, aucune cartographie agrégée de ce soutien. Alors que, dans le même temps, chaque euro investi auprès d’une association est contrôlé plusieurs fois et de différentes manières.
Austérité dangereuse
Cette politique de transfert de moyens budgétaires de l’État et de la Sécurité sociale vers les secteurs « marchands » de notre économie repose sur une croyance non étayée : « L’entreprise privée comme seule créatrice d’emplois et de richesses ». Or, le non-marchand produit aussi de la richesse, y compris monétaire, et aucune entreprise lucrative ne crée évidemment de l’emploi sans en avoir la nécessité. Elle le fait soit parce que la demande globale ou sectorielle l’encourage – c’est, dans ce cas, le consommateur qui, en augmentant son pouvoir d’achat, permet la création de l’emploi dans le secteur privé – soit parce que le contribuable, par le biais de l’État, subventionne des emplois privés.
Plus largement, ce sens commun de l’austérité nous apparaît comme dangereux pour la démocratie. Il a, d’une part, un effet performatif sur les travailleurs du secteur non-marchand qui, considérés par leurs représentants politiques comme des mendiants de l’argent public, en viennent à ne plus réfléchir leur action qu’en termes budgétaires. D’autre part, qu’on le veuille ou non, l’apprentissage de la démocratie et de la citoyenneté a un coût. L’histoire nous a montré qu’il n’y a pas de démocratie sans démocrates, sans un apprentissage de la citoyenneté tout au long de la vie. Dans ce contexte, l’investissement public dans l’enseignement, l’éducation permanente, la solidarité internationale et dans d’autres formes de gestion d’entreprises est crucial pour éviter les dérives autoritaires.
Le bien commun
Nous refusons d’être considérés comme des assistés. Le secteur non-marchand investit dans le bien commun. Chaque emploi, chaque projet, chaque service rendu contribue à renforcer la cohésion sociale, la participation citoyenne et la vitalité démocratique. À l’heure où les budgets se resserrent, rappelons qu’aucune économie ne prospère durablement sans justice sociale, sans culture partagée et sans citoyennes et citoyens capables de faire société. Cela passe aussi par une évaluation transparente et exigeante du soutien public au secteur privé lucratif, afin qu’il contribue réellement à l’emploi, à la transition et à l’économie locale.
Une carte blanche de Gresea, SAW-B, Solidaris, CNE, CSC-Enseignement, CSC Services Publics, Fédération des maisons médicales, CNCD, Smart, Fédération des Employeurs des Secteurs de l’Éducation permanente et de la Formation des Adultes (FESEFA), Interfédération des centres d’insertion socioprofessionnelle (L’interfédé CISP), Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP), Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC) et CONCERTES.
Notes
(1) « Un pognon de dingue ». Le soutien public aux entreprises privées lucratives en Belgique, https://www.econospheres.be/Un-pognon-de-dingue
(2) « Les aides publiques aux entreprises ont augmenté 1,5 fois plus rapidement que les dépenses sociales » https://www.econospheres.be/Les-aides-publiques-aux-entreprises-ont-augmente-1-5-fois-plus-rapidement-que
(3) https://www.senat.fr/notice-rapport/2024/r24-808-1-notice.html
(4) Docquier, Nicolas. 2024. « Réductions de cotisations sociales : quelle efficacité pour le marché du travail et quels effets sur le financement, la solidarité et l’équité du régime de Sécurité sociale des travailleurs salariés ? » Revue belge de Sécurité Sociale 66.