À lire ici : la note d’orientation du Gouvernement
Vous êtes nombreux et nombreuses à manifester votre inquiétude et votre incompréhension quant à la réforme en cours.
Smart, volontairement, n’a pas pris part aux débats qui se tiennent en la matière depuis presque deux ans : des fédérations et autres coordinations représentatives se sont créées, se sont mobilisées, ont animé ces débats – et cela nous semblait nécessaire que le terrain s’auto-organise ainsi pour défendre ses intérêts. Néanmoins il apparaît aujourd’hui que nombre d’entre vous se sentent finalement exclu·es de ces débats, de leurs fondements, de leurs aboutissements, ne comprennent pas les objectifs de cette note d’orientation, s’interrogent sur l’avenir …
Nous avons lu attentivement la note d’orientation, proposée comme l’aboutissement d’un long travail de concertation, élaborée par un « groupe technique » composé de diverses parties prenantes, dont le Gouvernement. Nous partageons vos interrogations.
Ce texte est un petit peu long, pas toujours simple à lire, mais l’importance des enjeux et la complexité du sujet nécessitent sans doute cet effort.
Mise à jour du 19 juillet 2021 : Plusieurs syndicats et associations, dont Smart, ont co-signé et envoyé un communiqué de presse remettant en cause le phasage de la réforme et la note d’orientation du WITA elle-même. on la trouvera ici et ici.
Rappel du contexte
Quel est le contexte ?
- Celui de la Sécurité sociale des salarié·es, et particulièrement de sa branche « chômage ».
- Celui du financement solidaire et interprofessionnel (intersectoriel) de cette sécurité sociale, par les travailleur·euses et les employeur·euses (via les cotisations sociales), mais aussi par l’État, via les formes de financement alternatif (la TVA, les accises, l’impôt de personnes physiques et des sociétés sont ainsi mis à contribution).
- Celui de règles particulières d’accès au chômage et à la protection contre la dégressivité des allocations de chômage pour des travailleur·euses dont les conditions de travail sont structurellement spécifiques.
- La Sécurité sociale, les droits sociaux, le droit du travail sont des éléments essentiels de notre citoyenneté. Ils sont l’objet de nombreuses tensions : idéologiques, mais aussi communautaires. Et ils concernent des millions de personnes.
Cela étant posé, la réforme en cours de débats ne peut avoir qu’une portée limitée si l’on souhaite des résultats rapides (ce qui n’empêche pas de lutter pour des réformes plus profondes à moyen ou long terme) : l’on ne modifiera pas de fond en comble le socle des principes et lois à la base de la Sécurité sociale et du droit au travail (et cela n’est pas souhaitable en l’état des rapports de forces dans notre société), l’on ne basculera pas à l’occasion de cette réforme (même si c’est souhaitable) d’une société libérale et concurrentielle, de « marché libre », à une société égalitaire et solidaire fondée sur le principe de « à chacun·e selon ses besoins, de chacun·e selon ses moyens », il n’y aura pas de « revenu universel », etc.
Le « statut des artistes »[1] est depuis 2002 parfaitement défini : à défaut d’être salarié·es sous contrat de travail, ils et elles sont quand même assujettis au régime général de la sécurité sociale et ce sont des salarié·es comme les autres, dans le périmètre du droit social : le « donneur d’ordre »[2] est assimilé à l’employeur (assimilé veut dire qu’il en assumera les obligations sociales, sans être l’employeur au sens du contrat de travail et du droit du travail). Bref, tous et toutes sont salarié·es quand bien même ne sont-ils.elles pas toutes.tous sous contrat de travail (les plasticien·nes, les auteur·trices, etc.). Rappelons que le contrat de travail ne s’impose, lui, qu’à la condition de la subordination du travailleur·euse à l’employeur. En très rapide résumé, sans cette subordination, le contrat de travail ne s’impose pas : néanmoins le travailleur·euse et le donneur d’ordre peuvent librement convenir d’une relation de travail subordonnée, mais nul ne peut les y forcer.
Il existait avant 2002 et jusqu’en 2014 d’ailleurs, un régime spécifique du chômage basé principalement sur deux articles des arrêtés « chômage » :
- le premier qui établissait la « règle du cachet » pour les artistes de spectacle (uniquement),
- et le second qui neutralisait la dégressivité des allocations de chômage pour tous et toutes les travailleur·euses qui exerçaient leur métier dans les liens de contrats de courte durée (seul le secteur de l’Horeca, qui disposait d’autres mesures, était exclu du champ d’application de cet article). L’on voit que ce second article visait tout le monde, et pas seulement les artistes. L’ONEM voulait cependant réserver ce second article aux seul·es artistes de spectacle. Après plus de 200 procès de travailleur·euses (défendu·es par Smart, par les syndicats, etc.) exerçant leur métier dans les liens de contrat de courte durée sans être “artiste de spectacle”, et réclamant l’application de cette mesure, procès tous perdus par l’ONEM, le Gouvernement a produit une réforme du chômage, en 2014, qui est celle que nous connaissons aujourd’hui. On peut lire ici un exposé didactique et assez complet de cette première réforme.
On notera au passage que la jurisprudence (avant et après la réforme de 2014) tend à élargir chaque année le périmètre des métiers et pratiques considérés comme « créant, exécutant ou interprétant une œuvre artistique » : ainsi, une graphiste réalisant des visuels pour impression sur T-Shirt vient de gagner son procès contre la Commission Artistes qui refusait de lui délivrer un « Visa artiste ». Ou encore une assistante de production a fait reconnaître, encore une fois par les tribunaux, son métier comme une fonction d’exécution d’une œuvre artistique.
Revenons à vos conditions de travail.
Sur le terrain, que constatons-nous ?
- Il y a des métiers fort divers qui concourent tous à la production, l’interprétation et/ou l’exécution d’une œuvre artistique : et tous ces métiers ne sont pas directement « artistiques » au sens usuel, sociologique du terme – sur lequel d’ailleurs nul ne s’accorde réellement (et d’une certaine manière tant mieux) ;
- Il y a des situations de relation d’emploi tout aussi diverses : ici on est en CDI, là on est en CDD, ici le contrat de travail s’impose et c’est bien du « temps de travail » qui est mis par le ou la travailleur·euse à disposition de son employeur·se, là c’est le résultat du travail qui est attendu par un tiers qui n’exerce pas nécessairement une quelconque autorité sur le travailleur ou la travailleuse, ici l’on rémunère à l’heure ou à la journée, là on rémunère au forfait ou à la pièce, etc. ;
- Il y a des marchés (libres et concurrentiels, on peut le regretter, mais ce n’est pas cette réforme qui modifiera cela) dont les pratiques sont encore plus diverses : là on paie un salaire, ici on achète une œuvre, là on verse un à-valoir sur des droits d’auteur, ici l’on expose sans verser un euro au plasticien, etc. 95% des travailleur·euses n’ont absolument aucun pouvoir de marché, aucune marge de négociation : le tarif proposé (quand il y en a un) est à prendre ou à laisser ;
- La discontinuité des opportunités de revenus, sous quelque forme que ce soit, est la forme dominante d’activité, alors que celle-ci est quasi permanente, sous d’autres formes, soit non rémunérées (le fameux « travail invisibilisé »), soit latérales, péri ou para-artistiques (enseignements, coaching, etc., fondées sur la pratique dans les secteurs de la création, mais qui ne sont pas un travail de création, interprétation ou exécution d’une œuvre artistique).
- La réforme imparfaite et lacunaire de 2014 a produit une sorte de monstre administratif dont les effets sur les travailleur·euses finissent par s’approcher de très près à du harcèlement et de la maltraitance ;
- Plus personne ne maîtrise réellement les « règles du jeu », et l’ONEM n’en finit plus de les interpréter à coup de notes d’interprétation plus ou moins « freestyle » ;
- Le contrôle de la disponibilité sur le marché de l’emploi vient écraser littéralement toute tentative de construire continûment et durablement un parcours professionnel, qui, répétons-le, est massivement fondé sur du « travail non rémunéré », mais non moins professionnel, et donc forcément sur une non-disponibilité sur le marché de l’emploi, au sens usuel du terme ;
- De nombreux et nombreuses travailleur·euses hors secteurs artistiques ou même culturels travaillent dans des conditions similaires à celles des artistes et technicien·nes de la création ;
- … et les travailleur·euses peinent à construire un discours commun qui rendent compte de la diversité des pratiques et des situations.
Quelles analyses tirons-nous de ces observations ?
1. Financer la Sécu à la hauteur des enjeux
Nous sommes persuadés que toute avancée sociale doit être financée, que les cotisations sociales et l’impôt doivent être prélevés auprès des travailleur·euses, équitablement, mais aussi que les utilisateur·trices d’œuvres et prestations (ils et elles sont très très nombreu·ses) doivent massivement contribuer à ce financement, quand ils et elles ne le font pas par le biais des cotisations sociales patronales.
Si l’on prend l’exemple des droits d’auteur dans l’édition : à supposer que ceux-ci soient dans certaines circonstances à définir assujettis aux cotisations sociales, il y a fort à parier que la part « employeur » de celles-ci seront prélevées sur le montant actuel des droits (dans l’édition, en général, 8% sur les ventes) et non payées en sus par les maisons d’édition. Le seul moyen de maintenir le niveau des droits est d’une part de les réguler (en fixant un plancher minimal) et d’autre part d’imposer les éditeur·trices et autres utilisateur·trices des œuvres (et autres prestations artistiques) par le biais d’une taxe directement destinée à abonder la Sécurité sociale. Une proposition en ce sens, extrêmement documentée, chiffrée, argumentée existe depuis près de 30 ans en la matière, qui avait été discutée au Parlement. Mais inutile de dire que l’on marche là en partie sur les plates-bandes des sociétés de gestion de droits …
Il est vain d’espérer le moindre progrès social sans briser le sacro-saint principe de neutralité budgétaire à l’œuvre dans la Sécu (depuis 2017[3]) ni sans mettre à contribution celles et ceux qui tirent profit, matériel ou symbolique (le symbolique finit toujours par se monnayer) de l’exploitation du travail, notamment artistique.
2. À situations analogues, traitements analogues
Ce sont des situations objectives de travail, de production, de relations d’emploi, de formes de rémunération, de parcours professionnels qui doivent guider toute évolution du droit social : à situations analogues, traitements analogues.
De nombreux et nombreuses travailleur·euses, dans les secteurs de la création, dans les secteurs culturels, et finalement dans tant d’autres secteurs, sont aujourd’hui soumis aux mêmes conditions de travail que les artistes et technicien·nes de la création. S’intéresser à ces derniers, spécifiquement, n’a de sens durablement que s’il s’agit de préfigurer des dispositifs applicables à toutes et tous, dans tous les secteurs, dès lors qu’ils ou elles travaillent dans des situations analogues.
Cette approche neutralise partiellement les effets néfastes de toute tentative de définir ce qu’est un artiste (puisque la définition ne sera que provisoire, le temps de s’adresser à toutes et tous), ce qu’est une oeuvre d’art, ce qu’est un·e « travailleur·euse des arts » … tentative qui finira toujours par aboutir à une bureaucratie qui manquera son objectif, à des fractures sur le terrain, à l’échec. Alors même qu’en matière de droit social, cette approche n’a guère de sens, sauf si elle s’affiche clairement comme l’entame d’un progrès social pour tous ceux et toutes celles qui en ont besoin. La « reconnaissance » que l’on espère (ou non) d’une société ne passe pas par le chômage ni par une quelconque Commission.
3. Les Communautés et les Régions doivent faire leur boulot, là où elles ont la main
Dans les secteurs de la création et de la culture, les Communautés (et pour partie en fait les Régions aussi) ont totalement la main pour contraindre (règlement d’octroi des subsides, contrats-programmes, etc.) chaque opérateur subsidié à rémunérer décemment les artistes et techniciennes et autres vacataires administratifs par exemple envers lesquels ces opérateurs ont des missions de service public déléguées. Le personnel politique actif à ces niveaux de pouvoir aujourd’hui botte en touche vers « le statut », créant ainsi le rideau de fumée qui masque leur total désinvestissement dans la question des rémunérations et de l’emploi dans les organismes qu’ils subventionnent et auxquels il délègue l’exécution de leurs politiques culturelles et d’aide à la création. Alors même que dans cette question, ces niveaux de pouvoir ont la main ! L’hypocrisie est à son comble.
Pour le dire tout net : le moindre pouvoir public, le moindre organisme subventionné par un pouvoir public, quand il expose un·e plasticien·ne (par exemple, nous en avons mille autres) devrait se contraindre (être contraint) à le ou la rémunérer a minima pour trois mois de travail – et c’est encore sous-payé. Tout comme un concert doit être payé non pas seulement pour le concert, mais pour l’amortissement réparti de l’investissement consenti pour aboutir à ce concert (matériel, temps de répétition, locaux, etc.).
Bref, ces Pouvoirs publics doivent devenir (aussi) les attributeurs de revenus suffisants pour permettre aux travailleur·euses dont ils tirent profit d’accéder aux droits sociaux qu’on leur promet. Nous ne pouvons laisser nos démocraties devenir ce que Sartre énonçait déjà il y a des dizaines d’années (en 1968 dans un amphi) : « la démocratie en milieu capitaliste est un ensemble de droits formels accompagnés de démentis concrets« .
4. Les entreprises privées doivent cesser d’abuser de la dépendance économique des travailleur·euses, quand ces derniers sont aussi producteurs, les premiers producteurs des biens et services dont ces entreprises tirent profit.
Pour ce qui est des opérateurs privés, sur lesquels les Communautés ni les Régions n’ont de pouvoir, il conviendrait d’étendre et d’activer l’Arrêté royal entré en vigueur mi-2020, interdisant l’abus de dépendance économique, qui peut faire l’objet d’une action en réparation collective (« class action »). Les maisons de productions, de diffusions, d’éditions, etc., parce qu’elles seules disposent des moyens de production et de diffusion des œuvres, doivent rendre compte de l’exploitation qu’elles font à vil coût de ces œuvres et prestations.
Un concert (qui est un « produit complet livré clé sur porte » et qui a demandé un investissement conséquent, et non du « temps de travail mis à disposition d’un employeur » pour la durée du concert) ne peut plus être acheté à 500 euros pour trois musicien·ne.s et un·e ingé son, un livre d’illustration pour enfants, qui a demandé jusqu’à six mois de travail pour un·e auteur·trice, ne peut plus enrichir le catalogue d’une maison d’édition avec 2.000 euros d’à -valoir sur des ventes futures sur lesquelles l’auteur·trice, en outre, n’a aucun moyen d’action. Une exposition dans une galerie, qui étoffe ainsi sa place sur le marché, ne peut plus être organisée sans rémunérer le ou la plasticien·ne qui a travaillé plusieurs mois pour ce faire… au prétexte que « ça lui donne de la visibilité et qu’il ou elle pourrait juste dire merci pour ça ».
5. Que le politique prenne ses responsabilités sans chercher à la transférer sur le terrain
Ce n’est pas aux travailleur·euses de « faire des propositions » de lois et règlements : c’est un piège cruel dans lequel il faut éviter de tomber. Ils ou elles ont à exposer objectivement leurs conditions de travail, les effets des règlements et lois sur leur vie quotidienne, les exclusions subies, l’humiliation causée par une bureaucratie aveugle et méprisante, en documentant, expliquant, illustrant… la diversité des causes, et les mêmes effets toxiques. Et c’est « au politique » à apporter des propositions de textes (et pas une « note d’orientation » d’un amateurisme confondant par ailleurs[4]), si sa volonté de réformer au bénéfice de toutes et tous est sincère et loyale. C’est à lui ou à elle de soumettre au débat ses propositions, non des débats réservés aux « représentant·es du secteur », mais au contraire accessibles à toutes et tous, éclairés par des analyses de juristes et avocats spécialisés, indépendants, de celles et ceux qui accompagnent depuis des années les artistes et les technicien·nes dans leurs combats.
Nous vous conseillons pour approfondir la question la lecture de :
- Sécurité sociale : portrait de l’artiste en contorsionniste (2014)
- Proposition de loi relative à l’application de la sécurité sociale aux artistes (1995)
Si vous en manifestez le souhait, nous reviendrons longuement sur ces questions et sur le débat en cours. Et pour mieux connaître vos souhaits, justement, merci de prendre trois minutes de votre temps pour répondre au petit sondage, anonyme et ouvert à toutes et tous, ici.
[1] et plus précisément de toute personne qui fournit contre rémunération une prestation ou produit une œuvre artistique, étant entendu que cela vise toute forme de « création, d’exécution ou d’interprétation d’une œuvre artistique dans les secteurs de l’audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie »
[2] en gros la personne morale ou physique qui paie la rémunération et qui a passé commande de l’œuvre ou de la prestation
[3] Lire par exemple : Le sous-financement de notre sécurité sociale n’est pas une fatalité
[4] On attend de voir une « Commission » traiter les 40 à 80.000 dossiers des « travailleur·euses des arts »… 40.000 selon le MR, 80.000 selon nous, pour ne parler que de ça.
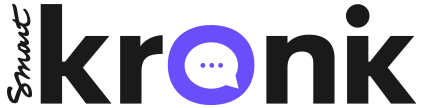

7 réponses sur « La réforme du régime chômage des artistes, technicien·nes et autres travailleur·euses des secteurs de la création »
Bravo ! Un texte clair. Je me permet de diffuser quelques extraits sur mes réseaux. Je rencontre des responsablescommunaux bientôt et ne manquerai pas de remettre une copie.
Bonjour Roger je lis un article d’Alain Lallemand dans Le Soir du 20 juillet 2022 qui titre « feu vert ». Serait-il possible d’avoir 1 ou 2 pages très concises et pratiques sur ce qui a été décidé et ce qui va être mis en place? Ca pourrait en intéresser pas mal 😉 Bon travail et merci déjà pour l’info! Matthieu
Hello toutes et tous …
Malgré les annonces publiques, nous n’avons pas les textes finaux, et ceux-ci ne seront pas votés avant septembre, voire octobre.
Il y a encore trop d’incertitudes pour proposer un « mode d’emploi » pratique.
L’Atelier des droits sociaux a néanmoins fait une première lecture des textes en l’état de mai 2022 : donc même si cette lecture est parfaitement éclairante, il est beaucoup trop tôt pour considérer que ce seront bien ces règles qui seront d’application à la fin de l’année …
Merci pour l’info! Voici le lien du document dont tu parles et donc, à voir fin d’année ce qui se concrétisera: https://ladds.be/wp-content/uploads/2022/06/Resume-des-mesures-de-la-reforme.pdf
Merci pour ce texte qui serait probablement très clair s’il n’était pas rendu illisible par cette écriture inclusive, qui n’est même pas appliquée de façon cohérente (utilisation à certains moments non justifiés et pas à d’autres où cela aurait du sens). Pitié ne tombez pas dans cette mode, il existe des façons d’écrire en respectant la grammaire officielle tout en étant pas sexiste ou exclusif.
Bonjour Eric Durieux, et merci pour votre remarque dont nous percevons la volonté positive.
Le sujet de cette réforme est étendu et complexe, donc le texte est effectivement détaillé.
L’ensemble de la communication de Smart évolue avec son époque, et cela fait plusieurs années que l’inclusive s’est installée dans les habitudes de nos publics. La demande dépasse de loin le cadre du style, on parle ici de reconnaissance humaine. Replacer le féminin (et des notions non-binaires) dans les textes n’est pas une question de mode, mais une reconstruction du langage pour que toutes et tous puissent s’identifier et se retrouver dans les explications liées au monde du travail. Bien sûr la volonté de départ se norme au contact de l’usage du public, et c’est cet usage qui définira « ce qui en restera dans 20 ans ». Smart ne veut pas être tenue parmi les entreprises qui n’auront pas entendu une énorme volonté de progresser en ce sens.
Par ailleurs, l’administration fédérale elle-même a recommandé l’utilisation de l’inclusive par un « guide pour une écriture respectueuse du genre » distribué aux équipes de fonctionnaires à la fin du mois de mai 2022. Smart avait juste anticipé cette évidence accueillie comme un réel progrès.
Évidemment c’est une terre jeune et encore meuble, donc l’écriture inclusive se simplifie, se rationalise, trouve ses chemins. En 2018 certains mots s’écrivaient avec deux point médian; la règle a évolué depuis 2020 avec un seul point, ou avec un suffixe plus court, sans séparer le pluriel, etc. On disait travailleur·euse·s, on préfèrera aujourd’hui travailleur·ses, il y a d’autres exemples dont nous tenons compte avec le temps et l’usage, conformément au manuel existant (cfr. « Manuel d’écriture inclusive », Raphaël Haddad, MotsClés éd., 2019).
Vous pouvez aussi remarquer que nous varions les formes, parfois en dédoublant le mot, parfois par l’inclusive, pour garder une fluidité de lecture. Tout dépend aussi des personnes et des styles ayant participé à l’article, au même titre que pour la ponctuation classique ou les temps utilisés, chacune et chacun a ses habitudes de rédaction.
Nous continuerons à tout faire pour que ce retour nécessaire du féminin et de formulations épicènes dans le langage ne pose aucun souci dans la fluidité de nos articles, et nous retenons réellement votre remarque en ce sens.
Bonnes lectures à vous.
Merci pour votre réponse. Je comprends vos motivations que je crois sincères, mais je ne peux m’empêcher de penser que c’est une erreur. Je pense et espère que dans 20 ans on se rendra compte que c’était une faute, que cela bloque complètement la fluidité de lecture.
Pour une simple et bonne raison : une lecture fluide se traduit par une sonorité mentale dans la tête, on « entend » ce qu’on lit dans son esprit, or comme on ne parle pas oralement en inclusif, cela ne pourra jamais être fluide dans une lecture mentale. L’écriture inclusive est bien une mode pour la simple raison que la langue française comportait déjà une solution à l’exclusion des genres avec le neutre. Quand vous dites « le soleil » vous ne pensez pas que c’est lié à l’homme, « la rivière » n’est pas lié à la femme, le pluriel neutre « ceux qui veulent » comprend bien les hommes et les femmes. J’espère que tout cela ne durera qu’un temps pour la beauté et surtout l’efficacité de la langue française.